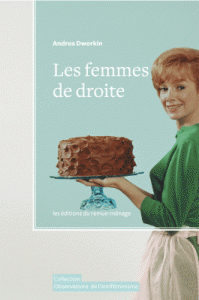«La politique de l’intelligence» d’Andrea Dworkin
Nous reproduisons aujourd’hui avec l’autorisation des Éditions du remue-ménage un extrait du livre Les femmes de droite, un classique d’Andrea Dworkin enfin disponible en français dans une percutante traduction de Martin Dufresne et Michele Briand. Cette collaboration inaugure une année d’échanges avec cette maison d’édition féministe, qui nous offrira matière à réflexions et à débats.
Extraits du chapitre « La politique de l’intelligence », dans Les femmes de droite (traduction de Right-Wing Women, d’Andrea Dworkin, 1983) :
Certains concèderont que les femmes peuvent avoir une sorte d’intelligence particulière – essentiellement petite, pointilleuse, douée pour les détails, inapte aux idées. Certains concèderont – souligneront en fait – que les femmes sont plus sensibles au « Bien », davantage portées à l’honnêteté ou à la bienveillance : un point de vue qui restreint et dompte l’intelligence. Certains concèderont qu’il y a eu des femmes de génie – après leur décès, bien sûr. Les plus belles plumes de la littérature anglaise ont été des femmes : George Eliot, Jane Austen, Virginia Woolf. Elles furent sublimes ; et elles furent, toutes et chacune, l’ombrede ce qu’elles auraient pu être. Mais leur existence ne change en rien la perception catégorique des femmes comme étant fondamentalement stupides : incapables d’exercer l’intelligence sans laquelle le monde entier se trouve appauvri. Les femmes sont stupides et les hommes, brillants ; les hommes ont droit au monde et les femmes, non. La perte d’un homme est la perte d’une intelligence ; la perte d’une femme est la perte d’une (cochez une fonction) mère, ménagère, chose sexuelle. Des catégories entières d’hommes ont été perdues, gaspillées ; il s’est toujours trouvé des gens pour pleurer leur perte et la combattre, pour refuser de l’accepter. Personne ne pleure l’intelligence perdue des femmes, parce que personne n’est convaincu que cette intelligence était réelle et a été détruite. En fait, on perçoit l’intelligence comme une fonction de la masculinité, et on méprise les femmes qui refusent leur propre perte.
Les femmes ont des idées stupides qui ne méritent pas d’être appelées des idées. Marabel Morgan écrit un livre idiot, superficiel, lamentable, où elle prétend que les femmes doivent exister pour leur mari, pour faire et être le sexe pour leur mari[i]. D.H. Lawrence écrit des essais vils et stupides où il dit essentiellement la même chose mais avec beaucoup de références au divin phallus[ii] ; D.H. Lawrence a du génie. Anita Bryant dit que sucer une queue équivaut à du cannibalisme ; elle déplore la perte de l’enfant qu’est le spermatozoïde[iii]. Norman Mailer croit que les éjaculations perdues sont des fils perdus et il décrie à ce titre l’homosexualité masculine, la masturbation et la contraception[iv]. Anita Bryant est stupide et Norman Mailer est génial. La différence tient-elle au style d’énonciation de ces idées identiques, ou au pénis ? Mailer dit qu’un grand écrivain écrit avec ses couilles ; la romancière Cynthia Ozick lui demande dans quelle couleur d’encre il trempe les siennes. Qui est le génie et qui est stupide ? Si une idée est stupide, il faut présumer qu’elle l’est que ce soit un homme ou une femme qui l’énonce. Mais ce n’est pas ce qui arrive. Les femmes, sous-éduquées en tant que classe, n’ont pas à lire Eschyle pour savoir que c’est l’homme qui plante le spermatozoïde, l’enfant, le fils ; les femmes sont la terre : elle porte l’être humain qu’il a créé ; il demeure l’origine, le père de la vie. Les femmes peuvent tirer ce savoir de leurs propres sources, provinciales, moralistes – des prêtres, des films, des profs de gym, c’est un savoir très répandu : respecté chez les écrivains mâles parce que ceux-ci sont respectés, stupide chez les femmes parce que la stupidité est tenue pour un trait congénital chez elles. Les femmes expriment ce savoir reçu, et soulèvent l’hilarité. Mais quand des écrivains mâles expriment les mêmes idées reçues, on les applaudit parce qu’ils sont intéressants, originaux, géniaux, et même rebelles, courageux d’affronter sans détour le monde du péché et du sexe. Les femmes ont des préjugés ignorants et moralistes ; les hommes ont des idées. Parler de deux poids deux mesures serait un cruel et complaisant euphémisme : ce système sexiste d’évaluation des idées agit comme une massue qui réduit en bouillie l’intelligence des femmes, l’annihile. Mailer et Lawrence ont toujours défi é le monde ; ils savaient y avoir droit ; leur plume tient ce droit pour acquis ; le monde est le champ gravitationnel où ils évoluent. Marabel Morgan et Anita Bryant arrivent tard à l’écriture et tentent d’agir sur le monde ; leur style est, bien sûr, immature et imprécis, ridicule même. Mailer et Lawrence ont tous deux écrit une foule de choses tout aussi ridicules et immatures, malgré tout ce qu’ils peuvent tenir pour acquis en tant qu’hommes, malgré leur maîtrise du langage, leurs authentiques réussites ou la beauté de tel ou tel récit ou roman. Mais on ne les qualifie pas de stupides même quand ils sont ridicules. Si l’on ne peut distinguer les idées de Lawrence de celles de Morgan, alors soit l’un et l’autre ont du génie, soit l’un et l’autre sont stupides ; et le même principe vaut pour Mailer et Bryant. Pourtant, seules les femmes ont droit à notre mépris. Les idées d’Anita Bryant sont-elles pernicieuses ? Alors, c’est aussi vrai de celles de Norman Mailer. Les idées de Marabel Morgan sont-elles hilarantes à s’en tenir les côtes ? Alors, c’est aussi le cas pour celles de D.H. Lawrence.
Une femme doit, pour survivre, garder son intelligence timide et restreinte. Il lui faut soit la cacher complètement, soit la masquer sous le voile du style, sinon, elle doit périodiquement devenir folle pour en payer le prix. Elle cherchera à exercer l’intelligence d’une manière qui sied aux dames. Mais l’intelligence n’est pas distinguée. L’intelligence déborde d’excès. L’intelligence rigoureuse abhorre la sentimentalité, et les femmes doivent être sentimentales pour tenir en estime la triste sottise des hommes qui les entourent. L’intelligence morbide abhorre le soleil radieux de la pensée positive et de la sempiternelle douceur ; et chaque femme doit être radieuse et enjouée et douce, ou elle ne pourrait acheter la paix du matin au soir par des sourires. L’intelligence à l’état libre exècre tout monde étroit, et le monde de chaque femme doit rester étroit, sinon elle devient hors la loi. Aucune femme n’aurait pu être Nietzsche ou Rimbaud sans finir dans un bordel ou être lobotomisée. Toute intelligence vitale a des questions passionnées, des réponses vigoureuses : mais les femmes ne peuvent se faire exploratrices, il ne peut y avoir des Lewis et Clark de l’esprit féminin. L’intelligence restreinte l’est non seulement par timidité, comme les femmes sont forcées de l’être, mais parce qu’elle soupèse prudemment les impressions et les faits reçus d’un monde extérieur que n’osent affronter les timides. Une femme doit plaire, et l’intelligence restreinte ne cherche pas à plaire ; elle cherche à savoir par discernement. En outre, l’intelligence est ambitieuse : elle veut toujours plus, pas plus de baise ou plus de grossesses, mais davantage d’un monde plus grand. Une femme ne peut avoir d’ambition à titre personnel sans être damnée.
Nous envoyons les fillettes à l’école. C’est généreux de notre part, parce que les filles ne sont pas censées savoir grand-chose et que, dans beaucoup d’autres sociétés, on ne les envoie pas à l’école et on ne leur enseigne ni à lire ni à écrire. Dans notre société, si généreuse à l’égard des femmes, on enseigne aux filles certains faits, mais pas l’esprit critique ni la passion du savoir. On éduque les filles à l’obéissance : l’éducation draine, punit, raille, chasse d’elles l’esprit d’aventure intellectuelle. Les écoles servent d’abord à réduire les perspectives de la fillette, sa curiosité, puis à lui enseigner certaines aptitudes, nécessaires au futur mari. On éduque les filles à demeurer passives face aux faits. On ne les imagine pas capables de créer des idées ou d’explorer la condition humaine. L’objectif intellectuel d’une fille est de bien se comporter. Une fille à l’intelligence dynamique doit être remise à sa place. Une fille intelligente doit utiliser son esprit pour trouver un mari plus intelligent qu’elle. Simone de Beauvoir a finalement choisi Sartre lorsqu’elle a décidé qu’il était plus intelligent qu’elle. Dans un film tourné alors qu’ils étaient vieux, Sartre, alors à la fin de son existence, demande à Beauvoir, la femme avec qui il a partagé une vie étonnante d’action et de hauts faits intellectuels : « Dites-moi… qu’est-ce que c’est que de se sentir dans la vie une dame de lettres[v] ? »
Carolina Maria de Jesus écrit dans son journal : « Tout le monde a un idéal dans la vie. Le mien est de pouvoir lire[vi]. » Elle a de l’ambition, mais c’est une ambition étrange pour une femme. Elle veut s’instruire. Elle veut avoir le plaisir de lire et d’écrire. Des hommes la demandent en mariage, mais elle soupçonne qu’ils l’empêcheraient de lire et d’écrire. Ils n’apprécieront pas le temps qu’elle prend pour elle seule. Ils n’apprécieront pas les autres objets de son attention. Ils n’apprécieront pas sa concentration, son amour-propre, la fierté que lui procure une relation directe au monde plus vaste des idées, des descriptions, des faits. Ses voisins la voient penchée sur des livres, ou plume et papier à la main au milieu des ordures et de la famine de la favela. Son idéal fait d’elle une paria : son désir de lire fait d’elle une exclue, plus encore que si elle s’asseyait dans la rue et se bourrait la bouche de poignées de clous. Où a-t-elle été chercher cet idéal ? Personne ne le lui a offert. Les deux tiers des analphabètes dans le monde sont des femmes. Pour être baisée, pour porter des enfants, nul besoin de savoir lire. Les femmes servent au sexe et à la reproduction, pas à la littérature. Mais les femmes ont des histoires à raconter. Elles veulent savoir. Elles ont des questions, des idées, des arguments, des réponses. Elles rêvent d’être au monde, pas seulement de saigner et d’extraire des bébés ruisselants de leurs entrailles. « Les femmes rêvent », écrivait Florence Nightingale dans Cassandra, « jusqu’à ne plus avoir la force de rêver ; ces rêves contre lesquels elles luttent tant, si honnêtement, vigoureusement et consciencieusement, et si inutilement, des rêves qui sont pourtant leur vie, sans lesquels elles n’auraient pu vivre ; ces rêves s’évanouissent enfin […]. Plus tard dans la vie, elles ne désirent ni ne rêvent plus ni d’activité, ni d’amour, ni d’intellect[vii]. »
Virginia Woolf, la plus splendide écrivaine moderne, nous a dit tant et plus combien il était pénible d’être une femme à l’intelligence créatrice. Elle nous l’a dit quand elle a chargé une grosse pierre dans sa poche et s’est avancée dans la rivière ; et elle nous l’a dit chaque fois qu’un de ses livres était publié et qu’elle glissait dans la folie – ne me faites pas mal à cause de ce que j’ai fait, je me ferai mal avant, j’en perdrai mes moyens et je souffrirai et je serai punie et peut-être alors n’aurez-vous pas besoin de me détruire, peut-être me prendrez-vous en pitié, il y a tant de mépris dans la pitié et je suis si fi ère, cela ne suffira-t-il pas ? Elle nous l’a aussi dit tant et plus dans sa prose : elle nous l’a montré dans ses romans, oh très délicatement pour éviter que l’on en prenne ombrage ; et elle a enveloppé ses essais de charme, polie pour s’assurer de notre politesse. Elle l’a néanmoins écrit clairement, même si ce ne fut pas publié de son vivant, et elle avait raison :
Une certaine attitude est requise – attitude de mise pour servir le thé ; attitude de mise le dimanche après-midi, ou dans des cercles bien féminins – est exigée de nous. Je ne sais. J’estime que le point de vue importe tout autant que la chose même. Ce que je prise, c’est le contact direct d’un esprit qui se livre, à nu. Souvent, il n’est pas possible de rien dire de valable sur un écrivain – hormis ce qu’on en pense. Or actuellement, je sens mon point de vue constamment aveuglé, fort inconsciemment sans doute, parce que rédacteur en chef et public désirent qu’une femme considère les choses d’un point de vue et avec une prudence, bien féminins. Or, écrits selon ce point de vue biaisé, mes articles tournent mal[viii].
Priser « le contact direct d’un esprit qui se livre, à nu », c’est avoir une intelligence virile, non voilée de robes et de jolis gestes. Oui, l’œuvre de Woolf a toujours mal tourné, entraînée par le poids exigeant d’être une femme. Elle apprit à maîtriser une indirection exquise, à dissimuler significations et messages dans un style féminin. Elle peina à ce style et se cacha derrière ce masque : et elle fut moins que ce qu’elle aurait pu être. Elle mourut non seulement de ce qu’elle osa, mais également de ce qu’elle n’osa pas.
Trois choses sont indissolublement liées : l’alphabétisme, l’intellect et l’intelligence créatrice. À en croire le cliché, ces choses distinguent l’homme des animaux. Celui à qui on les refuse est privé d’une vie pleinement humaine, dépouillé du droit à la dignité humaine. Maintenant intervertissons les genres. L’alphabétisme, l’intellect et l’intelligence créatrice distinguent-ils la femme des animaux ? Non. La femme ne peut se distinguer des animaux car elle a été condamnée, du fait de sa classe de sexe, à une vie de fonctions animales : être baisée, procréer. Dans son cas, les fonctions animales sont le sens de sa vie, sa prétendue humanité, la seule à laquelle elle peut prétendre, les capacités humaines les plus élevées à sa portée, parce qu’elle est une femme. Pour les éléments orthodoxes de la culture mâle, elle incarne l’animal, l’antithèse de l’âme ; pour les libéraux de la culture mâle, elle est la nature. Quand ils discutent des prétendues origines biologiques de la domination masculine, les mecs peuvent se permettre de se comparer à des babouins et à des insectes tandis qu’ils écrivent des livres et enseignent à l’université. Un professeur de Harvard ne refuse pas d’être titularisé sous prétexte qu’un babouin n’y a jamais eu droit. La biologie du pouvoir, c’est un jeu pour les mecs. C’est la façon mec de dire : elle ressemble plus au babouin femelle qu’à moi ; elle ne peut avoir aucune influence à Harvard puisqu’elle saigne, puisque nous la baisons, qu’elle porte nos enfants, nous la battons, nous la violons ; c’est un animal, son rôle est de procréer. Quant à moi, j’aimerais bien voir le babouin, la fourmi, la guêpe, l’oie ou le cichlidé qui a écrit Guerre et Paix. Plus encore, je veux voir l’animal ou l’insecte ou le poisson ou la volaille qui a écrit Middlemarch.
L’alphabétisme est un outil, comme le feu. C’est un outil plus perfectionné que le feu et qui a fait autant sinon davantage pour transfigurer le monde naturel et social. L’alphabétisme, comme le feu, est un outil qui doit être utilisé par l’intelligence. C’est aussi une capacité : la capacité de lire et d’écrire est une capacité humaine, mais qui peut être utilisée ou niée, réfutée, réduite à l’atrophie. On nie cette capacité aux personnes socialement méprisées. Mais cet interdit ne suffit pas, parce que les gens tiennent au sens. Le genre humain trouve du sens dans les expériences, événements, objets, communications, relations, sentiments. L’alphabétisme participe à la recherche du sens ; il contribue à rendre cette recherche possible. Les hommes peuvent nier aux femmes la capacité d’apprendre le grec ancien, mais certaines femmes l’apprendront quand même. Les hommes peuvent nier aux femmes pauvres ou de la classe ouvrière ou aux prostituées la capacité de lire ou d’écrire leur langue, mais certaines d’entre elles liront et apprendront quand même leur langue ; elles risqueront tout pour l’apprendre. Dans le Sud esclavagiste des États-Unis, la loi interdisait d’enseigner aux esclaves à lire ou à écrire ; mais quelques propriétaires d’esclaves l’ont enseigné, quelques esclaves l’ont appris, quelques esclaves l’ont appris sans aucune aide et quelques esclaves l’ont enseigné à d’autres. Selon la loi juive, il est interdit d’enseigner le Talmud aux femmes, mais certaines ont quand même étudié le Talmud. Les gens savent que l’alphabétisme confère de la dignité et élargit leurs horizons. Les gens sont avides d’explorer le monde dans lequel ils vivent au moyen du langage, qu’il soit parlé, chanté, récité ou écrit. Il faut de terribles punitions pour les détourner de cette volonté de connaître ce qu’apporte le fait de lire et d’écrire, parce que les gens sont curieux et attirés par l’expérience et par sa conceptualisation. Refuser l’alphabétisme à toute classe ou catégorie de gens constitue une négation de leur humanité fondamentale. On en prive traditionnellement les gens à qui on prête un caractère animal, non humain : les esclaves dans les sociétés esclavagistes ; les femmes dans les sociétés d’appropriation des femmes ; les groupes racialement avilis dans les sociétés racistes. L’esclave mâle est traité comme une bête de somme ; pas question de le laisser lire ou écrire. La femme est traitée comme une bête d’élevage : elle ne doit ni lire ni écrire. Quand les femmes en tant que classe se voient nier ce droit, celles qui acquièrent du savoir sont réprouvées : elles sont masculines, déviantes : elles ont nié leur matrice, leur con ; par leur alphabétisme, elles désavouent la définition de leur genre.
[…]
Les féministes semblent penser que le salaire égal pour un travail égal est une simple réforme, alors que c’est loin d’être une réforme : c’est une révolution. Les féministes ont refusé d’admettre qu’un salaire égal pour un travail égal demeure chose impossible tant que les hommes dominent les femmes, et les femmes de droite ont refusé de l’oublier. La dévalorisation de leur travail à l’extérieur du foyer renvoie les femmes à la maison et encourage chacune d’elles à appuyer un système où, à son point de vue, on paie l’homme pour les deux et sa part du salaire de l’homme dépasse ce qu’elle-même pourrait gagner.
Dans le marché de l’emploi, le harcèlement sexuel fixe irréversiblement le statut inférieur des femmes. Elles sont le sexe ; même quand elles font du classement ou tapent à la machine, les femmes sont le sexe. La violence débilitante, insidieuse du harcèlement sexuel règne sur le marché de l’emploi. Elle fait partie de presque tous les milieux de travail. Les femmes s’écrasent ; elles temporisent ; elles se soumettent ; elles abandonnent ; les rares femmes suffisamment braves luttent et se retrouvent piégées devant les tribunaux, souvent sans emploi, durant des années. Il y a aussi des viols en milieu professionnel.
Quelle place reste-t-il à l’intelligence – à l’alphabétisme, à l’intellect, à la créativité, au discernement moral ? Dans ce monde où vivent les femmes, circonscrites par les usages que font les hommes de leurs organes sexuels, où peuvent-elles cultiver des compétences, des talents, des rêves, de l’ambition ? À quoi sert l’intelligence humaine pour une femme ?
[…]
Woodhull était convaincue que l’accès au marché de l’emploi libérerait les femmes de la coercition sexuelle. Elle avait tort ; le marché de l’emploi est devenu, par la volonté des hommes, un autre lieu pour l’intimidation sexuelle, une autre aire de danger pour des femmes déjà aux prises avec trop de dangers. Woolf misait sur l’instruction et l’art. Elle aussi avait tort. Les hommes effacent les œuvres ; la misogynie les déforme ; l’intelligence des femmes est encore punie et méprisée.
Les femmes de droite ont examiné le monde ; elles trouvent que c’est un endroit dangereux. Elles voient que le travail les expose à davantage de danger de la part de plus d’hommes ; il accroît le risque d’exploitation sexuelle. Elles voient ridiculisées la créativité et l’originalité de leurs semblables ; elles voient des femmes expulsées du cercle de la civilisation masculine parce qu’elles ont des idées, des plans, des visions, des ambitions. Elles voient que le mariage traditionnel signifie se vendre à un homme, plutôt qu’à des centaines : c’est le marché le plus avantageux. Elles voient que les trottoirs sont glacials et que les femmes qui s’y retrouvent sont fatiguées, malades et meurtries. Elles voient que l’argent qu’elles-mêmes peuvent gagner au travail ne les rendra pas indépendantes des hommes, qu’elles devront encore jouer les jeux sexuels de leurs semblables : au foyer et aussi au travail. Elles ne voient pas comment elles pourraient faire pour que leur corps soit véritablement le leur et pour survivre dans le monde des hommes. Elles savent également que la gauche n’a rien de mieux à offrir : les hommes de gauche veulent eux aussi des épouses et des putains ; les hommes de gauche estiment trop les putains et pas assez les épouses. Les femmes de droite n’ont pas tort. Elles craignent que la gauche, qui élève le sexe impersonnel et la promiscuité au rang de valeurs, les rendra plus vulnérables à l’agression sexuelle masculine, et qu’elles seront méprisées de ne pas aimer ça. Elles n’ont pas tort. Les femmes de droite voient que, dans le système où elles vivent, si elles ne peuvent s’approprier leur corps, elles peuvent consentir à devenir une propriété masculine privatisée : s’en tenir à un contre un, en quelque sorte. Elles savent qu’elles sont valorisées pour leur sexe – leurs organes sexuels et leur capacité de procréation – alors elles tentent de rehausser leur valeur : par la coopération, la manipulation, la conformité ; par des expressions d’affection ou des tentatives d’amitiés ; par la soumission et l’obéissance ; et surtout par l’emploi d’euphémismes comme « féminité », « femme totale », « bonne », « instinct maternel », « amour maternel ». Leur détresse se fait discrète ; elles cachent les meurtrissures de leur corps, de leur cœur ; elles s’habillent soigneusement et ont de bonnes manières ; elles souffrent, elles aiment Dieu, elles se conforment aux règles. Elles voient que l’intelligence affichée chez une femme est un défaut, que l’intelligence réalisée chez une femme est un crime. Elles voient le monde où elles vivent et elles n’ont pas tort. Elles utilisent le sexe et les bébés pour préserver leur valeur parce qu’elles ont besoin d’un toit, de nourriture, de vêtements. Elles utilisent l’intelligence traditionnelle de la femelle – animale, pas humaine ; elles font ce qu’elles doivent faire pour survivre.
[i] Voir La Femme totale. Par exemple : « Au commencement, le sexe naquit dans le jardin. Le premier homme était seul. Les jours lui semblaient longs, les nuits plus longues encore. Il n’avait ni cuisinière, ni infirmière, ni personne à aimer. Dieu vit que l’homme était seul et qu’il lui fallait une compagnie, aussi, lui donna-t-il la femme, le meilleur présent que l’homme ait jamais reçu. » (p. 117). « Spirituellement, pour que leurs relations sexuelles leur apportent l’ultime satisfaction, les deux partenaires ont besoin d’un lien personnel avec leur Dieu. Quand cela se réalise, leur union est sacrée et belle et, mystérieusement, ils se confondent tous deux en un seul être. » (p. 116)
[ii] Par exemple : « La chrétienté a introduit le mariage dans le monde : le mariage tel que nous le connaissons […] L’homme et la femme, un roi et une reine avec un ou deux sujets et quelques mètres carrés de territoire leur appartenant : voilà ce qu’est réellement le mariage. C’est la véritable liberté, parce que c’est un véritable accomplissement pour l’homme, la femme et les enfants. » (Sex, Literature and Censorship, New York, The Viking Press, 1959, p. 98) « C’est la tragédie de la femme moderne […] Elle a l’assurance d’un coq mais elle fait constamment la poule. Apeurée par son identité de poulette, elle court en tous sens au sujet du vote, de l’aide sociale ou des sports ou du monde des affaires : elle est merveilleuse, plus masculine que l’homme […] Soudainement tout cela se déconnecte de son être fondamental de poulette et elle réalise qu’elle a perdu sa vie. La merveilleuse sécurité de poulette, la sépoulecurité qui est le véritable bonheur de la femme lui a été enlevée : elle ne l’a jamais eue […] Le néant ! » (Ibid., p. 49-50) « Aucun mariage n’est mariage s’il n’est pas fondamentalement et en permanence phallique, et s’il n’a pas de lien avec le soleil et la terre, la lune et les étoiles fixes et les planètes, le rythme des jours, le rythme des mois, le rythme des saisons, le rythme des années, des décennies, des siècles. Aucun mariage n’est mariage s’il n’est pas une correspondance de sang […] Le phallus est la colonne de sang qui emplit la vallée de sang d’une femme. » (Ibid., p. 101)
[iii] Par exemple : « Pourquoi croyez-vous qu’on appelle les homosexuels des fruits [N.D.T. : en argot américain] ? Parce qu’ils croquent au fruit défendu de la vie […]. Voilà pourquoi l’homosexualité est une abomination de Dieu. Parce que la vie est si précieuse pour Dieu et que c’est une chose si sacrée quand un homme et une femme s’unissent pour ne former qu’une seule et même chair et que la semence est fécondée – c’est alors que la vie est scellée, que la vie commence. Interférer de quelque façon dans ce processus – surtout par la consommation du fruit défendu, la consommation du spermatozoïde – voilà pourquoi c’est une telle abomination […] cela rend le péché de l’homosexualité encore plus hideux parce qu’il est antivie, dégénérescent. » (Playboy, mai 1978)
[iv] Par exemple : « […] mais si de ce merveilleux rapport sexuel vous n’êtes pas prêt à faire un bébé, il se peut alors que vous envoyiez quelque chose à l’égout pour toujours, à savoir la capacité que vous aviez de faire un bébé : la chose la plus merveilleuse qui soit en vous peut avoir été jetée dans un diaphragme ou gâchée à cause d’une pilule. Un homme pourrait sacrifier son avenir. » (The Presidential Papers, New York, Bantam Books, p. 142) « Parmi les millions de spermatozoïdes, il ne s’en trouverait que deux ou trois qui ont la moindre chance d’atteindre l’ovule… [Les autres] se baladent sans avoir la moindre idée qu’ils sont de vrais spermatozoïdes. Ils peuvent sembler de vrais spermatozoïdes sous le microscope, mais après tout, un Martien nous regardant au télescope peut penser que les bureaucrates communistes et les agents du FBI ont l’air exactement pareils… Le microscope électronique lui-même ne peut mesurer la striation de la passion dans un spermatozoïde. Ou la force de sa volonté. » (The Presidential Papers, p. 143) « Je hais la contraception […] Il n’y a rien que j’abhorre autant que le planning des naissances, le planning des naissances est une abomination. J’aimerais mieux voir ces satanés communistes débarquer ici. » (Ibid., p. 131) « Je crois qu’une des raisons pour lesquelles les homosexuels souffrent tant quand ils atteignent 40 ou 50 ans est que leur vie n’a rien à voir avec la procréation. Ils réalisent avec horreur que tout ce merveilleux sexe qu’ils ont eu dans le passé est disparu – où est-il maintenant ? Ils ont épuisé leur essence. » (Ibid., p. 144) « Mieux vaut commettre un viol que se masturber. » (Ibid., p. 140) « et si la semence était déjà un être humain ? Si désespéré qu’il / gratte, mord, coupe et ment, / brûle et trahit / tentant désespérément d’atteindre le four… » (« I Got Two Kids and Another in the Oven », dans Advertisements for Myself, New York, Perigee, 1981, p. 397)
[v] Josée Dayan, Simone de Beauvoir : un film…, Paris, Gallimard, 1979, p. 79.
[vi] Carolina Maria de Jesus, Le Dépotoir, trad. violante do canto, Paris, Stock, 1960, p. 36.
[vii] Florence Nightingale, Cassandra, Old Westbury, The Feminist Press, 1979, p. 49.
[viii] Virginia Woolf, Le Livre sans nom – Les Pargiter, trad. Sylvie Durastanti, Paris, Des femmes, 1987, p. 237-238.