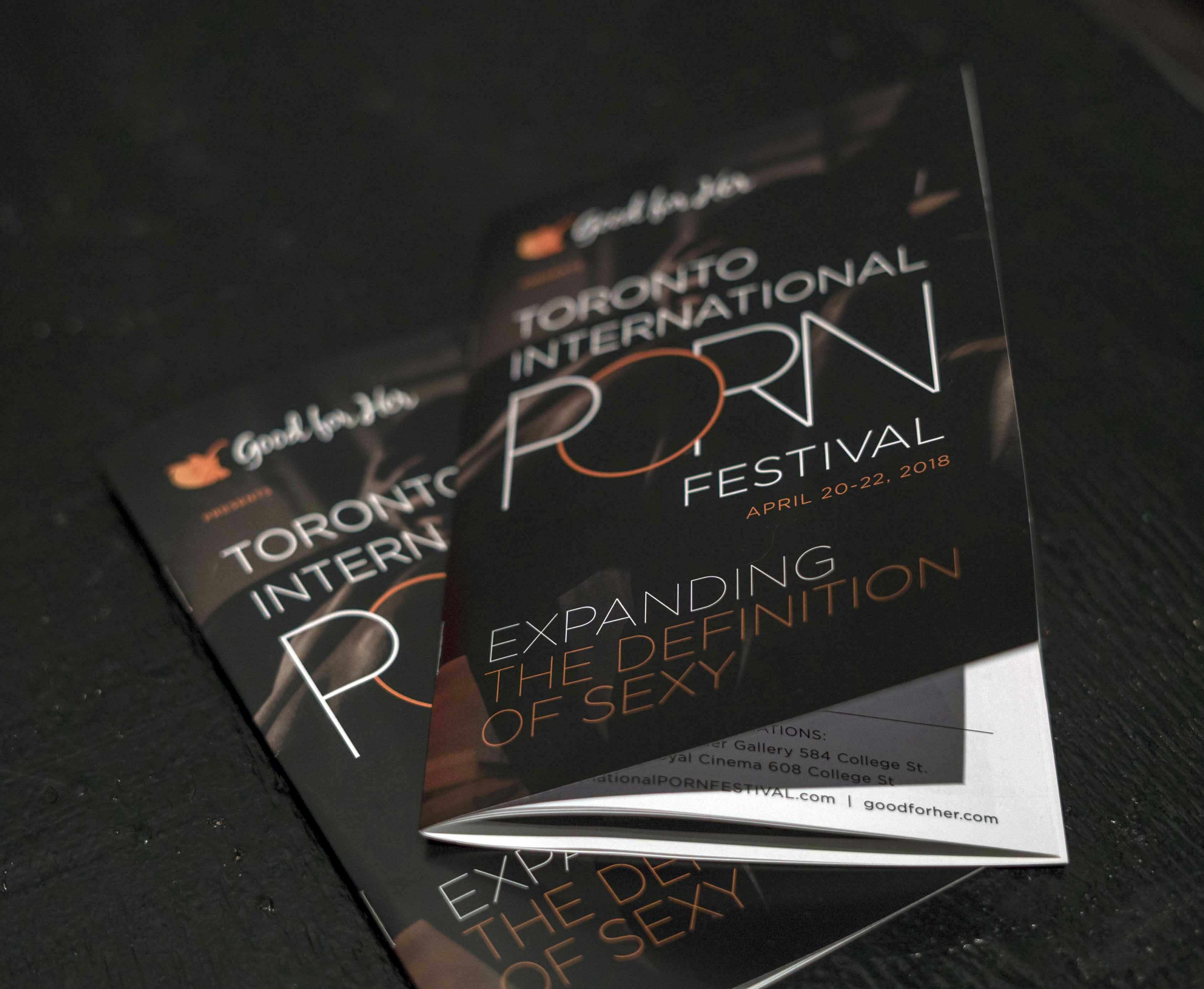
Premier jour au Toronto International Porn Festival
TIPF. Toronto International Porn Festival. C’est un grand nom pour un festival qui mérite définitivement d’être connu.
Existant depuis 2006, le festival, anciennement nommé Feminist Porn Awards, rassemble les acteurs.trices (réalisateurs.trices , producteurs.trices, et performeurs.ses) de cette industrie en constant changement.
Le porno ne repose pas seulement sur des plans serrés de verges immenses pénétrant grandiosement des multitudes de trous impersonnels. C’est aussi tout un champ d’action dans lequel des femmes, des hommes, des personnes trans, non-binaires, queer, des personnes de couleurs, des autochtones, travaillent pour faire briller la diversité de nos sexualités humaines, de nos désirs, de nos corps et de nos handicaps.
Ce festival est une ode à la diversité et porte haut et fort l’étendard de la visibilité de tous.tes et de leur représentation. Il porte un discours de changement social.
Good For Her, à l’origine de tout
Good for her. C’est là que le festival commence pour moi. Une boutique discrète sur Harbord street. Elle est le paradis des vagins, le paradis des pénis, des anus, des corps, des êtres qui désirent prendre du plaisir et partager cette merveilleuse chose qu’est la sexualité. On y trouve de tout : des vibromasseurs, des plugs, des fouets, des livres éducatifs. Un sex-shop on ne peut plus classique, me direz-vous. Sauf que non. Good for her est inclusif. C’est-à-dire que la clientèle peut se trouver n’importe où dans le spectre du genre et des orientations sexuelles et y trouver son bonheur. Les personnes en transition ou non-binaires sont les bienvenues ainsi que les adeptes de sexualités non-normatives. Chez Good For Her, on accueille avec un sourire et on accepte chacun tel qu’il, elle, they are.

Crédits photo: Mikael Carria
J’ai rencontré Carlyle, de Good For Her, qui est la fondatrice du festival, qui a fêté ses dix ans en 2016. Selon elle, depuis ses débuts, le festival a changé. Alors qu’en 2006, les alliés.es du projet étaient majoritairement des activistes féministes et queer, des gens plutôt issus de l’industrie, ou ses sympathisants.tes, aujourd’hui le festival rassemble aussi bien les consommateurs.trices que les gens du milieu. Elle me dit fièrement que cette année, elle attend les gens de la rue, qui ne portent pas nécessairement l’étiquette féministe, mais qui ont aussi le goût d’un porno positif, ouvert et diversifié. Le bouche à oreille permet au festival d’accueillir de plus en plus de personnes provenant de divers horizons. La mission du festival consiste à rendre visible les désirs et les sexualités de tous ceux et de toutes celles qui sont sous-représentés.es dans le milieu, en plus de féliciter les initiatives qui vont dans ce sens. Il s’agit d’encourager le mouvement, de le célébrer.
Les films : du rire, des aliens (ou presque) et de la (vraie) représentation
En cette première journée, plusieurs types de projections étaient au programme : Comic, Sci-Fi, Queer et Kinky.
On entre sans vraiment savoir ce qui nous attend dans la Wonder Gallery sur College Street. Un espace sombre, des rideaux rouges, un bar. Des gens calmes et souriants nous y accueillent.

Crédits photo: Mikael Carria
On s’assoit dans la salle, petite, à l’ambiance feutrée. Silence. C’est parti.
À l’écran, trois court-métrages de science-fiction. À l’issue; un vote. Soyons attentif. Dans le premier film, Prey (Jessie Sparkles, USA), il est question de chasseurs et de proies. On y voit deux hommes, l’un chassé, l’autre chasseur. On se sait pas vraiment qui est qui, l’atmosphère est tendue, électrique, aventureuse. Puis, sans qu’on s’en rende vraiment compte, on se souvient qu’il s’agit d’un film pornographique. Bondage, fellation, rapports de pouvoir, sperme, sang et lame de couteau, tout y est. C’est intense, je suis bouche bée.

Crédits photo: Mikael Carria
Deux autres courts, l’un est d’Erika Lust (Spain), “Touch Crimes”, bien connue du monde du porn féministe. Deux amants, pris en flagrant délit de hot sex hot love sont fait prisonniers dans un entrepôt post-futuriste. Interdiction complète de se toucher: ils sont enveloppés dans des combinaisons blanches. La femme est noire, l’homme est blanc, leurs peaux finissent par se mélanger, se fondre l’une dans l’autre, la sueur fait briller leurs courbes qui dansent dans un rapport animal. Les sexes s’aiment, et ne font qu’un. La dimension Sci-Fi se perd en cours de route, mais le court-métrage est beau. C’est d’ailleurs un peu toujours ce qu’elle fait, Érika Lust, du beau.
Le dernier film, Urbex Fuckers (Paolo Soares & Marcos Morais, Brésil), était étrange. Une espèce d’orgie lesbienne, par des lesbiennes aux ongles longs et aux corps chirurgicalement modifiés. Le film était long, très long.
On sort de la salle en essayant d’intellectualiser ce qu’on a vu. On vote, puis on passe à la suite des festivités.
Sex-Work and #Metoo Panel : une conversation nécessaire.
18h45. Je m’apprête sans le savoir à écouter l’une des conversations les plus importantes de mon expérience dans le milieu féministe.

Crédits photo: Mikael Carria
Le sujet : La question de l’inclusion de la communauté des travailleurs.euses du sexe (dans leur diversité de genres, d’origines, d’aptitudes physiques) au sein du mouvement #metoo.
Les panélistes :
1) Anna Saini : «world-class survivor», travailleuse du sexe depuis dix ans, d’origine indienne, activiste pour la défense des droits des travailleurs du sexe.
2) Robyn Sparkle : personne trans non-binaire, pratique le travail du sexe depuis 5 ans. Robyn représente les gens qui ont des différences physiques/mentales.
3) Luna : porte-parole de Maggie’s Toronto, plus de vingt ans dans l’industrie du sexe, autochtone, fervente activiste des droits humains et des droits indigènes, elle travaille notamment avec le Armour Project qui encourage l’awereness par l’art.
La modératrice :
Andrea Werhun. Anciennement travailleuse du sexe, elle est l’auteure du livre Modern Whore dans lequel elle parle de son enfance, essaie de démêler des enjeux féministes noués par des modes de pensées régis par un système de pouvoir empoisonné, soit l’hétéro-patriarcat blanc.
La conversation est animée, l’énergie est palpable et les mots sont forts, lourds de sens et de conséquences. Un constat commun : ces personnes ne se sentent pas incluses dans le mouvement #metoo tel qu’il a évolué depuis le mois d’octobre 2017.
Pourquoi ? Parce que le travail du sexe, en tant que choix, n’est pas une carrière accumulant les «viols rémunérés» (Andréa Werhun). Robyn Sparkle explique son expérience en tant que personne trans et non-binaire, à qui les droits de base ne sont pas accessibles. Aussi, Robin explique que l’exclusion s’inscrit dans la non-inclusivité des personnes non-normatives dans le mouvement, puisque ses protagonistes principaux sont des hommes cis et des femmes.
«Sex work is work»
Dans cette optique, les panélistes, à tour de rôle, mettent en valeur le fait que les crimes sexuels et le harcèlement sexuel au travail ne sont pas «part of the job» et que les travailleurs.euses du sexe méritent, comme tous.tes les autres travailleurs.euses, un accès aux ressources nécessaires pour se protéger de ces violences systémiques. En ce sens, tant que ces derniers.ières n’auront pas de statut légal au même titre que l’enseignant ou la chercheuse, alors #metoo ne sera pas inclusif.
Une solution unanime : la décriminalisation
Pour Anna Saini, un changement de statut légal (réalisé avec succès depuis 2003 en Nouvelle-Zélande) permettrait de reconstruire une relation de confiance avec la police censée protéger les travailleurs.euses du sexe des prédateurs, ainsi leurs conditions de travail seraient significativement améliorées. Notons par ailleurs que les unions et les syndicats existent déjà.
La relation avec les services d’ordre est difficile (et c’est peu dire). Luna nous rappelle justement que depuis 500 ans, les autochtones sont poursuivi.e.s par la police et que les femmes lors de leurs dénonciations ne sont pas prises au sérieux, voire sont victimisées. L’hypocrisie actuelle du gouvernement et des associations des droits humains nous mènent au constat que nous manquons de clairvoyance sur une situation dans laquelle aujourd’hui encore «indigenous women are silenced by sex» (Luna).

Crédits photo: Mikael Carria
«Let’s decolonize sex work»
Amenant dans la discussion la créatrice de #metoo, Tarana Burke, Anna Saini précise qu’au cœur de la mission de ce mouvement règne la nécessité de conscientiser les gens sur l’échelle des privilèges de nos différentes positions dans le système. Selon elle, «black women are at the core of #metoo, liberation for them means liberation for all of us». Elle parle d’un «cadre d’agressions» dans lequel on s’insère ou non.
C’est la raison pour laquelle nous devons développer une pensée décoloniale, déconstruire la manière manichéenne avec laquelle nous percevons trop souvent le monde, recalculer nos privilèges et faire en sorte de s’éduquer convenablement.
Quant à l’industrie du porn, l’espoir est grand. Luna déclare que dans cette spirale de trafic sexuel, le porn est «la crème de la crème». Une solution pour le public : payez pour le porno, supportez-le, parlez-en, échangez, informez-vous. Chacune de ses petites actions aide à améliorer les conditions professionnelles des travailleurs et des travailleuses du sexe et facilite leur lutte.
———————————-
Bilan jour 1 : Toronto ciel bleu, rencontres, discussions, on y parle de tout, de culture, d’art, de bouffe, de sexe, de politique et de féminisme.
J’y retourne vite. Je vous raconte le reste demain.
Et je vais peut-être repasser chez Good For Her, juste comme ça, par curiosité…
Alizée Pichot




Pingback: Interview with Hello Rooster : Ethical and feminist porn, a complex web of progress and abuse.